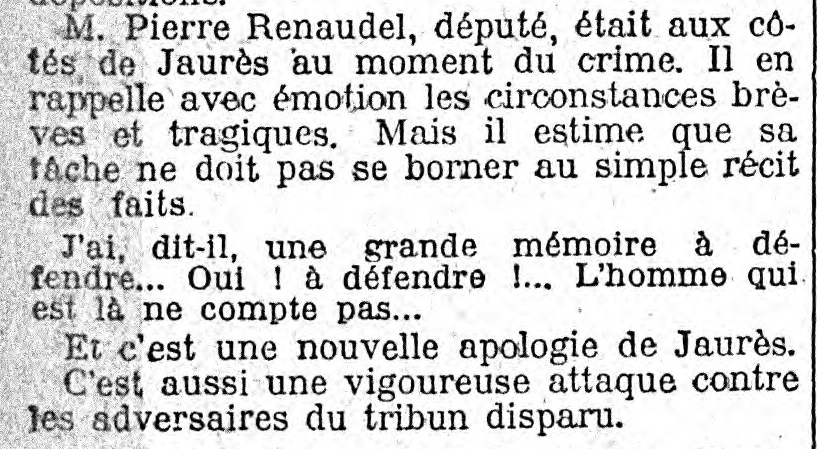Au cours des dix-sept premières années de son existence, les projets soutenus par la Banque mondiale consistent à améliorer des infrastructures de communication et la production électrique. L’argent prêté par la Banque aux PED doit surtout être dépensé dans les pays industrialisés. Les projets soutenus doivent améliorer les capacités d’exportation du Sud vers le Nord afin de satisfaire les besoins de celui-ci et d’enrichir une poignée de sociétés transnationales des secteurs concernés. Durant cette période, les projets en matière d’enseignement, de santé, d’accès à l’eau potable et d’assainissement des eaux usées sont inexistants.
Dès les débuts, les missions de la Banque visent essentiellement à augmenter sa capacité à influencer les décisions prises par les autorités d’un pays donné dans un sens favorable aux grandes puissances actionnaires et à leurs entreprises.
La politique de la Banque mondiale évolue en réaction au danger de contagion révolutionnaire et à la guerre froide. Les enjeux politiques interpellent les responsables de la Banque : leurs débats internes démontrent qu’ils y répondent en fonction des intérêts de Washington ou d’autres métropoles industrialisées.
L’activité de la Banque mondiale commence véritablement en 1946. Le 18 juin de cette année-là, Eugene Meyer, éditeur du Washington Post, ancien banquier, entre en fonction en tant que premier président de la Banque. Il tiendra six mois.
Les débuts de la Banque sont en effet difficiles. L’hostilité de Wall Street n’a pas vraiment diminué depuis la mort de Franklin Roosevelt en avril 1945. Les banquiers n’ont pas confiance dans une institution qui, à leurs yeux, est encore trop influencée par la politique du New Deal trop interventionniste et trop publique. Ils auraient préféré que les Etats-Unis développent de manière exclusive l’Export Import Bank. Ils se réjouissent du départ d’Henry Morgenthau qui n’est plus secrétaire au Trésor |1|, ne sont pas spécialement opposés à Eugene Meyer, président de la Banque, mais n’apprécient pas du tout les partisans d’un contrôle public que sont Emilio Collado et Harry White, respectivement directeur exécutif à la Banque mondiale et au FMI.
Dès 1947, des changements à la direction de la Banque leur donnent satisfaction car un trio favorable à Wall Street tient dorénavant les rênes du pouvoir : John J. McCloy est nommé président de la Banque mondiale en février 1947, il est secondé par Robert Garner, vice-président, et Eugene Black prend la place d’Emilio Collado. Auparavant John J. McCloy était un grand avocat d’affaires à Wall Street, Robert Garner était vice-président de General Foods Corporation et Eugene Black, vice-président de Chase National Bank. Par ailleurs, au FMI, Harry White est limogé. Wall Street est tout à fait satisfait. Avec le départ forcé d’Emilio Collado et d’Harry White, disparaissent les derniers partisans d’une intervention et d’un contrôle publics sur les mouvements de capitaux. Les « affaires » peuvent commencer.
La chasse aux sorcièresLa vie de la Banque mondiale et celle du FMI furent fortement influencées par la guerre froide et la chasse aux sorcières lancée aux Etats-Unis notamment par le sénateur républicain du Wisconsin, Joseph McCarthy. Harry White, père de la Banque mondiale et directeur exécutif des Etats-Unis au FMI, fait l’objet d’une investigation du FBI (Federal Bureau of Investigation) dès 1945 pour espionnage au profit de l’URSS |2|. En 1947, son cas est soumis au grand jury fédéral qui refuse d’entamer un procès.. En 1948, il est entendu par le Comité d’enquête contre les activités anti-américaines (Un-American Activities Committee). Victime d’une campagne hargneuse, il meurt d’une attaque cardiaque le 16 août 1948, trois jours après sa comparution devant le comité |3|. En novembre 1953, durant la présidence d’Eisenhower, le procureur général inculpe de manière posthume Harry White en tant qu’espion soviétique. Il accuse également le président Truman d’avoir désigné Harry White comme directeur exécutif au FMI en 1946 en sachant qu’il était un espion soviétique.
La chasse aux sorcières affecte également l’ensemble des Nations unies et de ses agences spécialisées car à la fin de son mandat, le 9 janvier 1953, le président Truman adopte un décret enjoignant au Secrétaire général des Nations unies et aux dirigeants des agences spécialisées de communiquer au gouvernement des Etats-Unis les informations concernant les candidatures introduites par des citoyens des Etats-Unis pour un emploi aux Nations unies. Les Etats-Unis se chargent de réaliser une investigation complète afin de détecter si cette personne est susceptible de se livrer à de l’espionnage ou à des actions subversives (telles « plaider la révolution pour altérer la forme constitutionnelle du gouvernement des Etats-Unis » |4|). A cette époque, le terme « un-american » est un euphémisme très courant pour caractériser un comportement subversif. Un élément subversif ne peut pas être embauché par l’ONU. L’immixtion des Etats-Unis dans les affaires intérieures de l’ONU est très poussée. En témoignent le ton et le contenu de la lettre envoyée par le secrétaire d’Etat J. F. Dulles de l’administration Eisenhower |5| au président de la Banque mondiale, Eugene Black : “ Le secrétaire d’Etat Dulles m’a demandé (écrit le sous-secrétaire d’Etat) de vous faire part de l’extrême importance qu’il accorde à l’obtention de la coopération totale de tous les responsables des agences spécialisées des Nations Unies dans l’exécution du décret présidentiel 10422. Il est persuadé que, sans cette pleine collaboration, les objectifs du décret ne pourront être atteints et que, sans cette condition, les Etats-Unis ne pourront pas continuer à soutenir ces organisations » |6|.
La Banque mondiale, pour prêter de l’argent à ses pays membres, doit commencer par emprunter à Wall Street sous la forme d’émission de bons d’emprunt |7|. Les banquiers privés exigent des garanties avant de prêter à un organisme public, d’autant qu’au début 1946, 87% des titres européens sont en défaut de paiement, de même que 60% des titres latino-américains et 56% des titres d’Extrême Orient |8|.
Avec le trio McCloy-Garner-Black aux commandes de la Banque, les banquiers privés délient un peu leur bourse car ils ont la garantie de récupérer la mise avec profit. Ils ne se trompent pas.
Au cours des premières années d’activité, la Banque prête principalement aux pays industrialisés d’Europe. Ce n’est que très timidement qu’elle se lance dans des prêts aux pays en développement. Entre 1946 et 1948, elle octroie des prêts pour un total d’un peu plus de 500 millions de dollars à des pays d’Europe occidentale (250 millions à la France, 207 millions aux Pays-Bas, 40 millions au Danemark et 12 millions au Luxembourg) tandis qu’elle n’octroie qu’un seul prêt à un pays en développement (16 millions au Chili).
La politique de prêt de la Banque mondiale à l’Europe va être bouleversée et réduite par le lancement du plan Marshall en avril 1948 car celui-ci dépasse de loin les possibilités de la Banque (voir partie 4 à venir). Pour la Banque, c’en est terminé de la partie « reconstruction » de son intitulé, seule la partie « développement » subsiste… Une des conséquences immédiates du lancement du Plan Marshall pour la Banque, c’est la démission un mois plus tard de son président, John J. McCloy, qui part en Europe pour occuper le poste de haut commissaire des Etats-Unis en Allemagne. Eugene Black le remplace et restera à ce poste jusqu’en 1962.
La révolution chinoise de 1949 fait perdre aux Etats-Unis un allié de taille en Asie et oblige les dirigeants de Washington à intégrer dans leur stratégie la dimension du « sous-développement » afin d’éviter la « contagion » communiste. Les termes du Point IV du discours du président Truman sur l’état de l’union de 1949 sont très éclairants : « Il faut lancer un programme audacieux pour soutenir la croissance des régions sous-développées… Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des conditions voisines de la misère … Leur nourriture est insuffisante, elles sont victimes de maladie… Leur vie économique est primitive et stationnaire, leur pauvreté constitue un handicap et une menace, tant pour eux que pour les régions plus prospères… Les Etats-Unis doivent mettre à la disposition des peuples pacifiques les avantages de leur réserve de connaissance technique afin de les aider à réaliser la vie meilleure à laquelle ils aspirent… Avec la collaboration des milieux d’affaires, du capital privé, de l’agriculture et du monde du travail des Etats-Unis, ce programme pourra accroître grandement l’activité industrielle des autres nations et élever substantiellement leur niveau de vie… Une production plus grande est la clef de la prospérité et de la paix, et la clef d’une plus grande production, est la mise en œuvre plus large et plus vigoureuse du savoir scientifique et technique moderne… Nous espérons ainsi contribuer à créer les conditions qui finalement conduiront toute l’humanité à la liberté et au bonheur personnel… » |9|.
Dès la première page du rapport annuel de la Banque mondiale qui suit le discours du président Truman, la Banque annonce qu’elle appliquera l’orientation du Point IV du discours : « A la date de publication de ce rapport, toutes les implications du programme Point IV et la manière précise de sa mise en oeuvre ne sont pas encore tout à fait claires. Cependant, du point de vue de la Banque, ce programme est d’un intérêt vital. (…) Les objectifs fondamentaux de la Banque en ce domaine sont essentiellement les mêmes que ceux du programme Point IV » |10|.
On a l’impression de lire le compte-rendu d’une réunion de parti exécutant un ordre de son comité central. Ceci dit, ce quatrième rapport annuel écrit sous le double coup de la révolution chinoise et du discours de Harry Truman est le premier à relever que les tensions politiques et sociales causées par la pauvreté et par l’inégalité dans la distribution de la richesse sont un obstacle au développement. La mauvaise répartition des terres, son caractère inefficace et oppressif en sont également.
Le rapport déclare qu’il faut éradiquer des maladies comme la malaria |11|, augmenter le taux de la scolarisation, améliorer le service public de santé… Par ailleurs, souligne le rapport, le développement du Sud est aussi important pour les pays développés car leur expansion dépend des marchés que constituent les pays sous-développés.
Dans les rapports suivants, les thèmes sociaux disparaissent progressivement et une vision plus traditionnelle reprend le dessus.
De toute manière, la Banque mondiale ne met pas en pratique la dimension sociale du Point IV dans sa politique de prêts. Elle ne soutient aucun projet visant la redistribution de la richesse et l’attribution de terres aux paysans qui n’en ont pas. En ce qui concerne l’amélioration de la santé, de l’éducation, du système d’adduction d’eau potable, il faut attendre les années 1960 et 1970 pour voir la Banque soutenir certains projets et encore, avec la plus grande circonspection.
Coûts élevés pour les emprunteurs
Les prêts de la Banque mondiale aux pays en développement (PED) étaient très onéreux : taux d’intérêt élevé (équivalent à celui du marché ou proche de celui-ci) auquel s’ajoutait une commission pour ses frais de gestion, période de remboursement assez courte. Cela provoqua très rapidement les protestations des PED qui proposèrent que l’ONU mette en place un financement alternatif et moins coûteux que celui de la Banque mondiale (voir partie 3 à venir).
Aujourd’hui, la Banque prête à un taux proche de celui du marché aux PED dont le revenu annuel par habitant est supérieur à 965 dollars. A l’image d’une banque classique, elle prend soin de sélectionner les projets rentables, sans oublier d’imposer des réformes économiques draconiennes. L’argent prêté provient majoritairement de l’émission de bons d’emprunt sur les marchés financiers. La solidité de la Banque mondiale, garantie par les pays riches qui en sont les plus gros actionnaires, lui permet de se procurer ces fonds à un taux avantageux. Les remboursements se font sur une période comprise entre 15 et 20 ans, avec une période de grâce de trois à cinq ans pendant laquelle le capital n’est pas remboursé. Cette activité de prêt est très lucrative : la Banque mondiale réalise d’appréciables bénéfices, de l’ordre de plusieurs milliards de dollars par an, sur le dos des pays en développement et de leurs populations |12|.
Pas un seul prêt pour une école jusqu’en 1962
La Banque mondiale prête pour des projets précis : une route, une infrastructure portuaire, un barrage, un projet agricole…
Au cours de ses dix-sept premières années d’activité, la Banque ne fait pas un seul prêt pour une école, pour un poste de santé, pour un système d’égout, pour l’adduction d’eau potable !
Au cours de ses dix-sept premières années d’activité, la Banque ne fait pas un seul prêt pour une école, pour un poste de santé, pour un système d’égout, pour l’adduction d’eau potable !
Jusqu’en 1962, tous les prêts, sans exception, sont destinés à des infrastructures électriques, à des voies de communication (routes, chemins de fer…), à des barrages, à la mécanisation de l’agriculture, à la promotion des cultures d’exportation (thé, cacao, riz…) ou, marginalement, à la modernisation d’industrie transformatrice.
Tourner les investissements vers l’exportation
Cela correspond à des priorités très claires : il s’agit d’augmenter la capacité des pays en développement d’exporter les matières premières, le combustible et les produits agricoles tropicaux dont les pays les plus industrialisés ont besoin.
L’analyse des projets acceptés ou refusés par la Banque mondiale indique de manière très claire qu’elle ne voulait pas soutenir, à quelques exceptions près, des projets industriels destinés à satisfaire la demande intérieure des pays en développement car cela diminuerait les importations en provenance des pays les plus industrialisés. Les exceptions concernent une poignée de pays stratégiquement importants et disposant d’une force de négociation réelle. C’était le cas de l’Inde.
L’argent prêté au Sud repart vers le Nord
La Banque mondiale prêtait de l’argent à condition qu’il soit dépensé par les PED sous forme de commandes de biens et de services aux pays les plus industrialisés. Comme le montrent les tableaux ci-dessous, au cours des dix-sept premières années, plus de 93% de l’argent prêté revenait chaque année dans les pays les plus industrialisés sous forme d’achats.
Répartition géographique des dépenses effectuées avec les sommes prêtées par la BM de 1946 à 1962


Source : Banque mondiale, Rapports annuels, 1946 à 1962
Ces données sont fournies par la Banque mondiale jusqu’en 1962. A partir de l’année suivante et jusqu’à aujourd’hui, ces données ne sont plus disponibles pour le public. L’explication en est simple : jusqu’en 1962, les pays riches qui dominent la Banque n’étaient pas du tout gênés de montrer que l’argent prêté leur revenait immédiatement. Au contraire, ils s’en vantaient pour montrer que la Banque leur profitait largement. Au fil du temps, de plus en plus de pays devenus indépendants ont adhéré à la Banque mondiale et il est devenu difficile de montrer dans le rapport public annuel de la Banque que ses activités bénéficiaient essentiellement à ses membres les plus riches.
Prêts odieux aux métropoles coloniales
Après dix ans d’existence, la Banque mondiale ne compte que deux membres en Afrique subsaharienne : l’Éthiopie et l’Afrique du Sud. En violation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, la Banque mondiale octroie des prêts à la Belgique, à la France, à la Grande Bretagne, pour financer des projets dans leurs colonies |13|. Comme le reconnaissent les historiens de la Banque : “ Ces prêts qui servaient à alléger la pénurie de dollars des puissances coloniales européennes, étaient largement destinés aux intérêts coloniaux, particulièrement dans le secteur minier, que ce soit par l’ investissement direct ou l’aide indirecte, comme pour le développement du transport et des mines » |14|. Ces prêts permettent aux pouvoirs coloniaux de renforcer le joug qu’ils exercent sur les peuples qu’ils ont colonisés. Ils contribuent à approvisionner les métropoles coloniales en minerais, en produits agricoles, en combustible. Dans le cas du Congo belge, les millions de dollars qui lui ont été prêtés pour des projets décidés par le pouvoir colonial ont presque totalement été dépensés par l’administration coloniale du Congo sous forme d’achat de produits exportés par la Belgique. Le Congo belge a reçu en tout 120 millions $ de prêts (en 3 fois) dont 105,4 millions $ ont été dépensés en Belgique |15|.
… légués comme un boulet aux jeunes nations indépendantes
Lorsque les colonies mentionnées plus haut accèdent à l’indépendance, les principaux actionnaires se mettent d’accord pour leur transmettre la charge de la dette contractée par le pouvoir colonial.
La preuve en est donnée par l’exemple de la Mauritanie. Le 17 mars 1960, la France se porte garante d’un prêt de 66 millions de dollars contracté par la Société anonyme des mines de fer de Mauritanie (MIFERMA). La Mauritanie est encore une colonie française pour très peu de temps puisque son indépendance sera proclamée le 28 novembre de la même année. Ce prêt doit être remboursé entre 1966 et 1975. Selon le rapport annuel de la Banque, six ans plus tard, la Mauritanie indépendante a une de dette de 66 millions de dollars envers elle |16|. Le prêt contracté sur demande de la France alors que la Mauritanie était sa colonie est devenu une dette de la Mauritanie quelques années plus tard. La Banque a généralisé ce procédé qui consiste à transférer la dette contractée par un pouvoir colonial au nouvel Etat indépendant.
Or un cas comparable s’est déjà présenté dans le passé et a été tranché par le Traité de Versailles. Lors de la reconstitution de la Pologne en tant qu’Etat indépendant après la première guerre mondiale, il a été décidé que les dettes contractées par l’Allemagne pour coloniser la partie de la Pologne qu’elle avait soumise ne seraient pas à charge du nouvel Etat indépendant. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 stipulait : « La partie de la dette qui, d’après la Commission des Réparations, prévue audit article, se rapporte aux mesures prises par les gouvernements allemand et prussien en vue de la colonisation allemande de la Pologne, sera exclue de la proportion mise à la charge de celle-ci… » |17|. Le Traité prévoit que les créanciers qui ont prêté à l’Allemagne pour des projets en territoire polonais ne peuvent réclamer leur dû qu’à cette puissance et pas à la Pologne. Alexander-Nahum Sack, le théoricien de la dette odieuse, précise dans son traité juridique de 1927 : « Lorsque le gouvernement contracte des dettes afin d’asservir la population d’une partie de son territoire ou de coloniser celle-ci par des ressortissants de la nationalité dominante, etc., ces dettes sont odieuses pour la population indigène de cette partie du territoire de l’Etat débiteur » |18|. Cela s’applique intégralement aux prêts que la Banque a octroyés à la Belgique, à la France et à la Grande Bretagne pour le développement de leurs colonies. En conséquence, la Banque agit en violation du droit international en faisant porter aux nouveaux Etats indépendants la charge de dettes contractées pour les coloniser. La Banque en connivence avec ses principaux actionnaires coloniaux et avec la bénédiction des Etats-Unis a posé un acte qui ne peut rester impuni. Ces dettes sont frappées de nullité et la Banque doit rendre compte de ses actes à la justice. Les Etats qui ont été victimes de cette violation du droit devraient exiger des réparations et utiliser les sommes en question pour rembourser la dette sociale due à leur peuple |19|.
Les missions de la Banque mondiale
La Banque mondiale affectionne d’envoyer des spécialistes en mission dans certains pays membres. Au cours des vingt premières années, il s’agit dans la plupart des cas de spécialistes des Etats-Unis.
Au départ, le pays « test » le plus visité est incontestablement la Colombie. C’est un pays clé du point de vue des intérêts stratégiques des Etats-Unis. Une des priorités de Washington est d’éviter que la Colombie ne bascule dans le camp soviétique ou dans la révolution sociale.
Dès 1949, la Banque envoie en Colombie une mission très fournie, composée d’experts de la Banque, du FMI, de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture) et de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé). Il s’agit d’étudier les besoins et de déterminer une stratégie globale de développement pour le pays. Les projets concrets soutenus par la Banque concernent l’achat aux Etats-Unis de 70 bulldozers, de 600 tracteurs et de l’équipement de trois centrales hydroélectriques ! En 1950, on apprend que le gouvernement colombien étudie le rapport établi par la Commission de la Banque afin de formuler un programme de développement sur cette base. Et l’année suivante, en 1951, une commission d’experts indépendants colombiens termine l’élaboration d’un tel programme de développement, que le gouvernement applique : réforme budgétaire et bancaire ; réduction et assouplissement des restrictions à l’importation ; assouplissement des contrôles de change ; adoption d’une attitude libérale et incitative à l’égard des capitaux étrangers.
Des consultants désignés conjointement par la Banque et le gouvernement colombien élaborent également des propositions concernant les chemins de fer, l’aviation civile, l’investissement industriel et l’émission de titres de la dette publique. Un conseiller économique nommé par la Banque a été engagé par le National Board of Economic Planning de Colombie. Dans le rapport annuel de 1953, on apprend la mise en place d’instances de planification. Laissons la parole à un des pontes du FMI, Jacques Polack |20|, à propos de sa participation à une mission en Colombie : « Les instructions verbales que j’ai reçues en tant que responsable de la mission de 1955 du FMI en Colombie, formulées dans une réunion entre le vice président de la Banque et le directeur exécutif du Fonds (…), disaient clairement, dans le langage vigoureux de l’époque, : ‘Vous leur tordez le bras droit et nous leur tordrons le gauche |21|’ ».
On le voit, en général, ces missions visent essentiellement à augmenter la capacité de la Banque (et d’autres institutions, en particulier le FMI) à influencer les décisions prises par les autorités d’un pays donné dans un sens favorable aux grandes puissances actionnaires et à leurs entreprises.
La politique de la Banque mondiale évolue en réaction au danger de contagion révolutionnaire et à la guerre froide
En 1950, le camp allié aux Etats-Unis dans la Banque mondiale expulse de fait la Chine qui est passée en 1949 du côté communiste et attribue son siège au gouvernement anticommuniste du général Tchang Kai Chek installé sur l’île de Taiwan |22|. Afin d’éviter la contagion au reste de l’Asie, différentes stratégies seront utilisées et certains pays clés feront l’objet d’une intervention systématique de la Banque mondiale. C’est le cas de l’Inde |23|, du Pakistan, de la Thaïlande, des Philippines, de l’Indonésie. Jusqu’en 1961, la Banque ne sera pas autorisée à s’occuper de la Corée du Sud qui constitue un domaine exclusivement réservé aux Etats-Unis.
La Pologne et la Tchécoslovaquie qui adhèrent au bloc soviétique, quittent très vite la Banque |24|. La Yougoslavie, qui est expulsée du camp soviétique, reçoit par contre un soutien financier de la Banque.
L’année 1959 commence par un énorme ouragan révolutionnaire qui secoue les Amériques : la victoire de la révolution cubaine au nez et à la barbe de l’oncle Sam |25|. Washington est obligé d’accorder des concessions aux gouvernements et aux peuples d’Amérique latine pour tenter d’éviter que la révolution ne se propage comme une traînée de poudre vers d’autres pays.
L’historien de la Banque, Richard Webb, ex-président de la Banque Centrale du Pérou, a bien pris la mesure du phénomène : “ Entre 1959 et 1960, l’Amérique latine a reçu tout le bénéfice de la révolution cubaine. Les premiers effets sont apparus avec la décision d’établir une banque interaméricaine de développement et de répondre - après une longue résistance - aux demandes latino-américaines de stabilisation des prix des matières premières, un accord sur le café est ainsi signé en septembre 1959. L’aide a augmenté au début de l’année 1960 après les expropriations massives à Cuba, le pacte commercial de l’île avec l’URSS et le voyage d’Eisenhower en Amérique latine. ‘ A mon retour’, écrit-il, ‘ j’avais l’intention de mettre en place des mesures historiques visant à mettre en oeuvre des réformes sociales bénéficiant à tous les peuples de l’Amérique latine’ » |26|.
Le président D. Eisenhower ajoute : “ On se trouvait sans cesse confronté à la question de ce qu’on pouvait faire à propos du ferment révolutionnaire dans le monde. (…) Il fallait de nouvelles mesures politiques qui s’attaqueraient à la racine du problème, le bouillonnement révolutionnaire. (…) Une suggestion était (…) d’augmenter le salaire des enseignants et de mettre sur pied des centaines d’écoles professionnelles. (…) Il nous fallait nous-mêmes écarter certaines vieilles idées (…) pour empêcher le Monde Libre de partir en flammes » |27|.
L’historien de la Banque, Richard Webb poursuit : « En avril, le secrétaire d’Etat, Christian A. Herter a informé l’Union pan-américaine d’un grand changement dans la politique étrangère américaine vis-à-vis de l’Amérique latine y compris une décision de soutenir la réforme agraire. Dillon a, en août, présenté un nouveau programme d’aide au Congrès qui demandait à la Banque interaméricaine de développement un financement de 600 millions de dollars de prêts à taux concessionnels et qui mettait l’accent sur les dépenses sociales pour répondre aux inégalités de revenus et aux institutions dépassées représentant deux sérieux obstacles au progrès. La loi est rapidement entrée en application.
La perception de la crise dans la région a continué en 1961 et Kennedy a franchi un degré supplémentaire dans la réponse : ‘ Avec Berlin, c’est la région la plus critique. (…) Le prochain coup pourrait venir de n’importe quel coin de la région. (…) Je ne sais pas si le Congrès me soutiendra mais il serait grand temps alors qu’ils sont tous complètement effrayés à l’idée que Castro réussisse à propager la révolution dans tout l’hémisphère’ [28].En mars 1961, Kennedy a demandé qu’on réagisse pour empêcher le chaos en Bolivie. Son gouvernement a décidé de ne pas prendre en compte les demandes du Fonds monétaire international et du département d’Etat qui voulaient appliquer à la Bolivie un paquet de mesures d’austérité anti-inflationnistes et au lieu de cela, d’offrir une aide économique immédiate. (…) ‘Les choses étaient suffisamment sombres sans encore demander davantage de sacrifices à ceux qui n’avaient rien à donner’ |28|. Une semaine plus tard, Kennedy annonçait l’Alliance pour le Progrès avec l’Amérique latine, un programme de dix ans pour la coopération et le développement qui mettait l’accent sur les réformes sociales avec une aide massive pour les pays qui ‘ y mettait du leur’ » |29|.
L’annonce de grandes réformes n’empêche pas la Banque et les Etats-Unis de soutenir des régimes dictatoriaux et corrompus comme celui d’Anastasio Somoza au Nicaragua. En voici un exemple. Le 12 avril 1961, alors que cinq jours plus tard, les Etats-Unis allaient lancer une expédition militaire contre Cuba à partir du territoire nicaraguayen |30|, la direction de la Banque décide d’octroyer un prêt au Nicaragua en sachant parfaitement que l’argent servira à renforcer la puissance économique du dictateur. Cela fait partie du prix à payer pour son soutien à l’agression contre Cuba. Ci-dessous un extrait du compte-rendu officiel interne de la discussion entre dirigeants de la Banque, ce 12 avril 1961 |31| :
- M. [Aron] Broches. J’apprends que la famille Somoza est partout et qu’il serait difficile de trouver quoi que ce soit au Nicaragua sans tomber sur eux.
![]() M. [Robert] Cavanaugh. Je ne voudrais pas avoir l’air de promouvoir un accord qui demanderait au peuple de vendre des terres convoitées par le président.
M. [Robert] Cavanaugh. Je ne voudrais pas avoir l’air de promouvoir un accord qui demanderait au peuple de vendre des terres convoitées par le président.
![]() M [Simon] Cargill. Si le projet en lui-même est satisfaisant, je ne pense pas que l’intérêt du président pose un problème tel qu’il faille l’abandonner.
M [Simon] Cargill. Si le projet en lui-même est satisfaisant, je ne pense pas que l’intérêt du président pose un problème tel qu’il faille l’abandonner.
![]() M Rucinski. Je suis d’accord qu’il est trop tard pour faire marche arrière.
M Rucinski. Je suis d’accord qu’il est trop tard pour faire marche arrière.
![]() M. Aldewereld. Le problème de la propriété des terres et de la famille Somoza est malencontreux mais nous le savions depuis le début et il est trop tard pour en discuter maintenant.
M. Aldewereld. Le problème de la propriété des terres et de la famille Somoza est malencontreux mais nous le savions depuis le début et il est trop tard pour en discuter maintenant.
Quelques mois plus tard, en juin 1961, les mêmes dirigeants de la Banque débattent d’un prêt à accorder à l’Equateur. Le contenu de la discussion est révélateur des enjeux politiques globaux qui motivent l’action de la Banque |32| :
- “M. Knapp. L’Equateur semble être le prochain pays à devenir “fideliste”. (…) Quel risque politique pose la population indienne invisible qui représente la moitié ou les deux tiers du pays, et qui est encore complètement en dehors de la situation politique et économique ?
![]() M. [John] de Wilde. L’Equateur a eu un bon parcours. Ne serait-ce pas le moment opportun pour les agences (…) comme la Banque de se manifester (…) afin (…) d’éviter une détérioration de la situation politique ?
M. [John] de Wilde. L’Equateur a eu un bon parcours. Ne serait-ce pas le moment opportun pour les agences (…) comme la Banque de se manifester (…) afin (…) d’éviter une détérioration de la situation politique ?
![]() M. Knapp. (...) Ça, c’est le genre de basses œuvres que les Etats-Unis doivent accomplir .
M. Knapp. (...) Ça, c’est le genre de basses œuvres que les Etats-Unis doivent accomplir .
![]() M. Broches. Où se place l’Equateur par rapport à l’indice de l’injustice sociale auquel se réfère M. Kennedy ?
M. Broches. Où se place l’Equateur par rapport à l’indice de l’injustice sociale auquel se réfère M. Kennedy ?
![]() M [Orvis] Schmidt. S’il y a de grandes disparités dans la distribution de la richesse en Equateur, celles-ci sont moindres que dans d’autres pays d’Amérique latine. (…) Les Indiens dans la montagne sont encore tranquilles, bien que le gouvernement n’ait pas vraiment fait grand’ chose pour eux.
M [Orvis] Schmidt. S’il y a de grandes disparités dans la distribution de la richesse en Equateur, celles-ci sont moindres que dans d’autres pays d’Amérique latine. (…) Les Indiens dans la montagne sont encore tranquilles, bien que le gouvernement n’ait pas vraiment fait grand’ chose pour eux.
![]() M. Demuth. Si l’on regarde les pays féodaux d’Amérique latine, (…) il faut être réaliste et se rendre compte que des révolutions vont avoir lieu. On ne peut qu’espérer que les [nouveaux gouvernements] vont honorer les obligations de leurs prédécesseurs.
M. Demuth. Si l’on regarde les pays féodaux d’Amérique latine, (…) il faut être réaliste et se rendre compte que des révolutions vont avoir lieu. On ne peut qu’espérer que les [nouveaux gouvernements] vont honorer les obligations de leurs prédécesseurs.
![]() M. Alderweredl. Le colonialisme est certainement mauvais en Equateur (…) même (…) pire qu’en Extrême Orient. Il va se passer quelque chose de violent. (…) Je crois que nos projets doivent servir à réduire les pressions internes. (…) Je suis d’accord que l’on pourrait accorder plus de crédits de l’agence internationale de développement pour pallier les risques politiques.
M. Alderweredl. Le colonialisme est certainement mauvais en Equateur (…) même (…) pire qu’en Extrême Orient. Il va se passer quelque chose de violent. (…) Je crois que nos projets doivent servir à réduire les pressions internes. (…) Je suis d’accord que l’on pourrait accorder plus de crédits de l’agence internationale de développement pour pallier les risques politiques.
![]() M. Knapp. (...) Mais les risques politiques conduisent à des défauts de paiement.
M. Knapp. (...) Mais les risques politiques conduisent à des défauts de paiement.
On ne peut être plus clair…
Partie 1
Partie 2